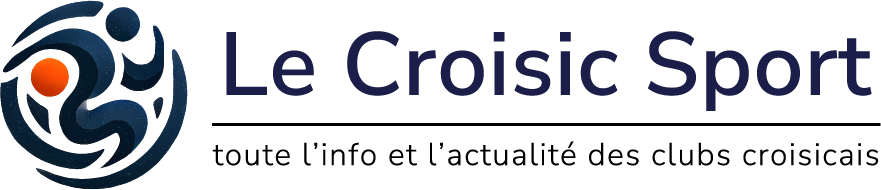Héritage Paris 2024 : avenir du sport français selon Guillaume Dietsch

Analyse et perspectives sur le sport en France après Paris 2024
À la suite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la France se retrouve face à un défi majeur : transformer l’engouement national en un véritable héritage Paris 2024 durable. Guillaume Dietsch, enseignant en STAPS et agrégé d’EPS à l’Université Paris-Est Créteil, partage son analyse sur les réussites et les manquements d’un système qui brille par ses champions, mais peine à soutenir la pratique sportive pour tous.
Héritage Paris 2024 : du rêve olympique à la réalité quotidienne
Un été de gloire, un automne de désillusion
Paris, septembre 2024.
L’effervescence des Jeux Olympiques et Paralympiques s’estompe peu à peu. Les drapeaux tricolores disparaissent des balcons, les écrans géants se démontent et les rues de Paris retrouvent progressivement leur rythme habituel. Pendant deux mois, la France a vibré au diapason de ses champions, savourant chaque médaille, chaque exploit et chaque instant de communion. Des soirées mémorables ont rassemblé des millions de téléspectateurs tandis que les réseaux sociaux s’enflammaient au rythme des performances historiques.
Des médailles aux réalités locales
Cette réalité s’est particulièrement ressentie lors de la rentrée sportive. Dans plusieurs communes, de nombreuses familles se heurtent à la même réponse : « Complet – inscriptions closes ». À Aubervilliers, devant la piscine rénovée pour les JO, des parents repartent déçus, leurs enfants encore animés des rêves olympiques nourris tout l’été. Ce contraste entre l’image de grandeur et le quotidien traduit le décalage entre les promesses de l’héritage Paris 2024 et sa mise en œuvre concrète.
C’est ce décalage que souligne Guillaume Dietsch, enseignant en STAPS et agrégé d’EPS et enseignant-chercheur à l’Université Paris-Est Créteil :
« Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est l’écart entre le feu d’artifice des Jeux et la réalité du sport au quotidien. Pendant deux mois, la France a vibré pour ses champions, mais sur le terrain, les structures manquent toujours pour accueillir l’élan populaire. »
De la célébration mondiale à la réalité locale
La France a brillé sur la scène internationale et confirmé son rang parmi les grandes nations sportives. Pourtant, le contraste entre l’excellence de l’élite et les difficultés de la base est saisissant et parfois même décourageant.
« Nous savons organiser des Jeux et briller le temps d’un événement mondial, explique Guillaume Dietsch. Mais nous avons encore du mal à transformer cet élan en héritage durable. »
Ce fossé se reflète aussi bien dans les statistiques que dans la vie quotidienne des clubs et associations, éléments essentiels du tissu sportif français. Les infrastructures vieillissantes, les bénévoles épuisés et les budgets contraints ne permettent pas de répondre à la demande croissante suscitée par l’effet JO.

Une pratique sportive en progression, mais inégalitaire
Le Baromètre national des pratiques sportives 2024 (INJEP/Crédoc) dresse un bilan contrasté :
58 % des Français de 15 ans et plus pratiquent régulièrement une activité physique,
71 % la pratiquent au moins occasionnellement,
80 % si l’on inclut les mobilités actives comme la marche ou le vélo.
Ce dynamisme est encourageant, mais il cache des fractures. 42 % des Français restent éloignés d’une pratique régulière.
Les freins sont bien identifiés : manque de temps, coût des inscriptions, contraintes professionnelles ou familiales, problèmes de santé et absence d’équipements accessibles.
« Nous sommes capables de remplir des stades et de suivre avec passion des événements planétaires, souligne Guillaume Dietsch. Mais nous n’avons pas encore réussi à faire du sport un réflexe quotidien pour tous. »
La motivation principale reste la santé (50 %), devant le plaisir (28 %), la convivialité (9 %) et la compétition (10 %).
Cette hiérarchie illustre une évolution culturelle vers un sport perçu avant tout comme un vecteur de bien-être et de qualité de vie.
Mais la pratique reste inégalement répartie selon les territoires et les catégories sociales, ce qui pose un défi majeur pour l’héritage Paris 2024.
Les jeunes et l'urgence d'agir pour l'activité physique
Chez les enfants et adolescents, la situation est alarmante. En 2024, 37 % des 6-10 ans et 73 % des 11-17 ans ne respectent pas la recommandation de 60 minutes d’activité physique quotidienne. Ce chiffre illustre une sédentarité grandissante qui inquiète de plus en plus les professionnels de santé et les éducateurs.
Cette baisse d’activité n’est pas uniforme : elle est marquée par des inégalités sociales et de genre.
Les filles, notamment à l’entrée au collège, sont plus nombreuses à abandonner, tout comme les jeunes issus de milieux modestes.
Ainsi, la fracture sociale se creuse, reflétant un accès très inégal à la pratique sportive et rendant plus complexe la réussite d’un véritable héritage Paris 2024.
Pour tenter d’inverser la tendance, plusieurs initiatives ont été mises en place. Parmi elles, on peut citer :
les 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école primaire,
les programmes Aisance aquatique et Savoir rouler à vélo,
le label Génération 2030 dont l’objectif est de transformer durablement les habitudes de vie dans 13 000 établissements d’ici 2030.
Cependant, ces dispositifs, bien qu’encourageants, restent dispersés et manquent de financements suffisants pour être pleinement efficaces. Guillaume Dietsch plaide pour une refonte complète de l’EPS afin de lui redonner un rôle central :
« L’EPS devrait être la colonne vertébrale de notre culture sportive. Avec seulement 4 heures par semaine en 6ᵉ, 3 heures ensuite et 2 heures au lycée, elle ne peut pas remplir ce rôle. Et c’est la seule matière dont on peut être dispensé aussi facilement. »
Il rappelle enfin que l’EPS ne se limite pas à une simple dépense d’énergie, mais qu’elle a une véritable dimension citoyenne :
« L’EPS n’est pas un défouloir. C’est un espace où l’on apprend par son corps à développer sa motricité, la coopération, le respect des règles, tout en s’ouvrant à différentes activités sportives. »
Infrastructures sportives en France : un réseau vieillissant et inégal
Le parc sportif français compte 182 700 équipements en 2023, soit 27 pour 10 000 habitants.
Mais ce chiffre global masque de profondes disparités :
Zones rurales : peu de piscines et de gymnases, parfois à plus de 30 minutes de route,
DROM-COM : 15 licences sportives pour 100 habitants, contre 23 en métropole,
Villes moyennes : infrastructures vieillissantes, rarement rénovées depuis les années 1980.
Ces inégalités se traduisent par des difficultés concrètes :
manque de créneaux horaires,
fermetures temporaires d’équipements pour cause de vétusté,
impossibilité d’accueillir de nouveaux pratiquants.
Conséquence directe : plus d’un Français sur dix a vu une inscription refusée en 2024, et 30 % des familles concernées ont renoncé à trouver une alternative.
Ce constat remet en cause l’ambition de l’héritage Paris 2024, qui devrait garantir un accès équitable au sport.

Budget du sport : financements en baisse et ambitions fragilisées
En 2022, le budget du ministère des Sports représentait 987 millions d’euros, soit 0,3 % du budget de l’État.
Après l’effort consenti pour les JO, la tendance est à la réduction :
2025 : budget à 1,578 Md€, en baisse de 12,8 %,
2026 : nouvelles coupes et projets gelés.
Le Pass’Sport, aide de 70 € pour les licences, peine à compenser cette contraction budgétaire et reste insuffisant pour garantir un accès équitable à la pratique sportive.
De nombreux clubs se retrouvent en difficulté pour recruter des éducateurs ou maintenir leurs installations en état.
« On crée de l’envie grâce aux Jeux, mais sans moyens derrière, on fabrique surtout de la frustration et de la désillusion », prévient Guillaume Dietsch.
Un modèle associatif à bout de souffle
Le sport français repose sur 152 000 clubs et 300 millions d’heures de bénévolat, soit 180 000 emplois équivalents temps plein.
Ce modèle unique est aujourd’hui fragilisé par :
des dirigeants vieillissants,
une complexité administrative croissante,
la baisse des subventions publiques.
Les bénévoles, pilier historique du système, s’épuisent et peinent à trouver une relève.
« Être président de club, c’est gérer une PME sans salarié ni budget. Beaucoup finissent par abandonner », regrette Guillaume Dietsch.
Sans soutien accru, le risque est grand de voir disparaître des structures essentielles, notamment dans les zones rurales et les quartiers populaires, ce qui menacerait directement l’héritage Paris 2024.
Vers un modèle français à inventer pour le sport
À l’étranger, plusieurs modèles existent qui offrent des pistes de réflexion :
États-Unis : sport intégré au système scolaire et universitaire, avec un fort financement privé,
Royaume-Uni : héritage mitigé des JO 2012, montrant les limites des grands événements comme moteur de transformation,
Slovénie : suivi physique systématique des enfants et culture sportive ancrée dès le plus jeune âge,
Norvège : culture sportive inclusive, axée sur le bien-être et la pratique pour tous,
Chine et Russie : culture de la performance avec entraînement intensif dès l’enfance, modèle difficilement transposable en France.
Pour Guillaume Dietsch :
« Nous devons trouver notre propre voie, en valorisant notre réseau associatif et la mixité sociale. Copier des modèles étrangers serait une erreur. »
Cette réflexion implique de repenser le rôle de l’État, des collectivités et des fédérations, afin de mieux coordonner les efforts et de garantir un accès démocratique au sport sur tout le territoire.
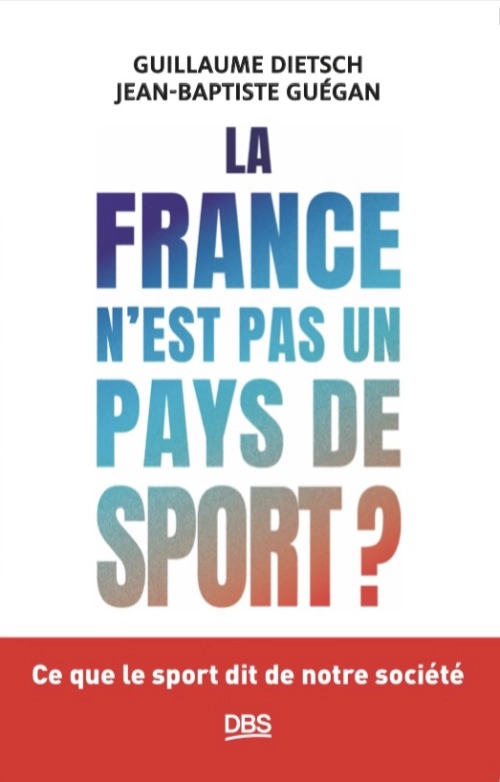
Conclusion : transformer l'héritage des Jeux Olympiques
Alors que l’écho des Jeux s’estompe, la France se trouve à la croisée des chemins.
Ce moment charnière invite à réfléchir : rester une grande nation de spectacle, brillante l’espace d’un été, ou devenir une nation sportive, où chaque citoyen peut pratiquer dans des conditions dignes et accessibles ?
Guillaume Dietsch conclut avec gravité :
« La vraie victoire des JO ne se joue pas sur un podium, mais dans les gymnases municipaux, les cours d’école et les clubs de quartier. »
Dans la continuité de cette réflexion, son dernier ouvrage coécrit avec Jean-Baptiste Guégan, La France n’est pas un pays de sport ? Ce que le sport dit de notre société (De Boeck Supérieur, 2025), prolonge le débat et explore les tensions et espoirs qui traversent notre société.
Prévu pour le 18 septembre 2025, ce livre invite chaque lecteur à se questionner sur la place qu’il souhaite accorder au sport dans son quotidien et dans la vie collective, et à imaginer les pistes pour un avenir où le sport serait véritablement au service de tous.